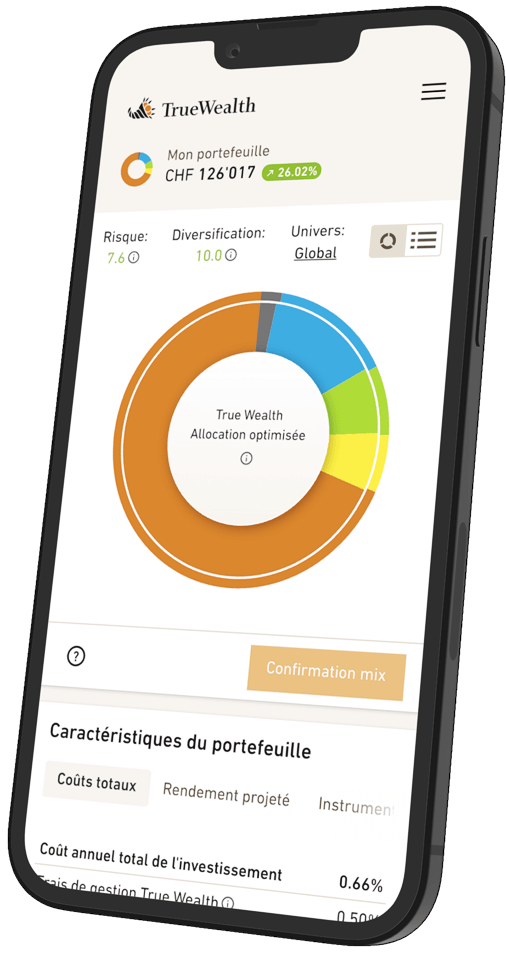Talk – Qu'en est-il de la mobilité sociale en Suisse?
Que signifie «culture économique» et pourquoi est-elle essentielle à la démocratie directe et à la mobilité sociale en Suisse? Entretien avec l'économiste Dr Melanie Häner-Müller.
Madame Häner-Müller, vous combinez analyse économique, réflexion sociopolitique et engagement en faveur de la politique éducative. L'un des axes principaux de votre travail est l'éducation économique ou, comme vous l'appelez, l'«economic literacy». Qu'est-ce que l'«economic literacy» et pourquoi est-elle importante?
Eh bien, pour simplifier, il s'agit en fait de la capacité à percevoir les relations économiques dans la vie quotidienne, à posséder des connaissances économiques et à savoir les appliquer.
La «financial literacy», c'est-à-dire les connaissances financières classiques, qui font généralement partie de l'«economic literacy», est sans doute mieux connue. Mais l'«economic literacy» va au-delà. On peut peut-être bien l'illustrer à l'aide de l'exemple d'un taux d'intérêt. En matière de «financial literacy», il faudrait savoir ce qu'est un taux d'intérêt, comment le calculer, peut-être aussi la croissance, l'effet des intérêts composés, etc.
Mais en matière de culture économique, on voudrait peut-être savoir: «Comment un tel taux d'intérêt est-il fixé? Quel est son rapport avec la politique monétaire? Pourquoi change-t-il?». Cela peut sembler abstrait, et on peut se demander: «Pourquoi faut-il avoir toutes ces connaissances si l'on n'est pas économiste?» Mais en Suisse, avec la démocratie directe, c'est extrêmement important, car la plupart des projets soumis au vote ont des répercussions économiques. Il est donc essentiel que les citoyens soient informés et qu'ils connaissent et comprennent les concepts économiques généraux et les notions de base.
Cela signifie-t-il que la démocratie directe implique en quelque sorte l'obligation d'avoir des connaissances économiques?
Tout à fait, oui. Et cela est même un peu réciproque. Dans une démocratie directe, lorsque les gens participent souvent à des initiatives et vont voter, ils s'intéressent davantage aux questions économiques et s'informent mieux. Il y a donc une certaine influence réciproque. Nous savons par exemple que les personnes ayant une meilleure culture économique ont davantage tendance à voter, s'intéressent donc davantage à la politique et osent peut-être plus facilement cocher une case sur le bulletin de vote. C'est donc très important pour une démocratie directe, et pas seulement pour les économistes.
Qu'en est-il des possibilités d'ascension sociale dans notre pays? La Suisse est-elle socialement mobile?
La réponse simple est oui. Pour compliquer un peu les choses, si l'on se demande quelle est l'influence du milieu familial sur le revenu, on peut par exemple comparer des frères et sœurs. En économie, on s'intéressait autrefois souvent à la relation parents-enfants, ce qui est également important, mais les frères et sœurs sont encore plus appropriés pour la comparaison. En effet, les frères et sœurs partagent beaucoup de choses qui dépassent largement l'influence parentale. Ils fréquentent par exemple la même école, ont peut-être un cercle d'amis similaire et des réseaux sociaux similaires.
Nous avons examiné dans quelle mesure l'origine familiale globale contribue au revenu en Suisse, et ce chiffre s'élève à 15 pour cent. Nous avons même retracé cette proportion jusqu'aux années 80. Au cours des 40 dernières années, elle est restée très stable, avec une moyenne d'environ 17 pour cent. Il est maintenant difficile d'interpréter ce que signifient ces 17 pour cent. À l'inverse, cela signifie qu'environ 85 pour cent ne s'expliquent pas par la famille, mais par des caractéristiques individuelles. C'est déjà une chose. La comparaison au niveau national est également utile: aux États-Unis, près de 50 pour cent s'expliquent par la famille, et même dans les pays scandinaves, qui sont toujours considérés comme des sociétés très mobiles, environ 20 pour cent peuvent s'expliquer par la famille. Cela signifie que nous sommes vraiment parmi les meilleurs.
Wow, mieux que les pays scandinaves?
Exactement, même mieux que les pays scandinaves en termes de revenus. Mais on entend souvent dire – et c'est vrai – que les «enfants d'universitaires» sont souvent surreprésentés dans les universités. On entend alors souvent dire: «Oui, mais cela signifie que l'égalité des chances n'est pas vraiment garantie en Suisse.» Et en effet, si l'on examine le niveau d'éducation, la famille explique environ 33 pour cent des différences en Suisse. Cela signifie qu'environ un sixième du revenu et un tiers de la réussite scolaire sont dus aux parents.
La question qui se pose alors est la suivante: «Comment cela s'explique-t-il?», car si l'on prend l'exemple des États-Unis, peu importe que l'on mesure les chances d'ascension sociale en termes de revenus ou d'éducation. Ceux qui ont un diplôme d'une université prestigieuse de l'Ivy League, qui ont étudié dans les meilleures universités américaines, obtiennent plus tard les revenus les plus élevés.
Et ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire en France, par exemple, ont-ils des difficultés?
Exactement, c'est différent en Suisse. Cela est notamment dû au système éducatif suisse, qui est très dualiste et perméable. C'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles notre mobilité salariale est si élevée et qu'il existe finalement de nombreux moyens d'obtenir un revenu élevé. Heureusement, beaucoup de choses ne dépendent pas de la famille. En tant que chercheuse, je dois peut-être décrire autre chose que nous avons fait dans le cadre de ce projet. Nous sommes remontés jusqu'au Moyen Âge afin de pouvoir analyser 15 générations consécutives. Et maintenant, on se demande naturellement: «Comment fait-on cela exactement?»
Nous n'avons pas pu exhumer de données fiscales et reconstituer des arbres généalogiques remontant jusqu'à 1550. Nous nous sommes intéressés à Bâle et avons utilisé une analyse des noms de famille. Autrement dit, qui s'est inscrit à l'université de Bâle au cours des 15 générations? Et comment s'appellent ces personnes? Ces informations sont documentées de manière exhaustive et l'université de Bâle est la plus ancienne université de Suisse. Nous avons ensuite examiné la répartition des noms de famille dans l'ensemble de la société bâloise. Nous avons évalué les registres de baptême et de naissance et examiné la répartition des noms de famille dans l'ensemble de la société. Cela nous a permis de voir, pour chaque génération, comment se composait l'élite et comment se composait la société dans son ensemble. On peut ainsi voir quelles familles étaient surreprésentées ou sous-représentées à l'université. J'ai pris l'exemple de l'université. Nous avons également travaillé avec d'autres données, par exemple des données sur les corporations, certaines données fiscales et des informations sur les professions.
Nous disposions d'une grande quantité de données que nous pouvions utiliser. En fait, c'était simple: les noms classiques de Bâle sont par exemple «Burckhardt», «Merian» ou «Faesch». On peut alors se demander: combien d'étudiants, parmi l'élite, portent ces noms de famille et combien y en a-t-il dans l'ensemble de la société? Par exemple, si les «Burckhardt» représentent 5 pour cent des étudiants, mais seulement 1 pour cent des nouveau-nés ou de l'ensemble de la société, alors les «Burckhardt» sont cinq fois plus représentés à l'université.
Cependant, nous n'avons pas seulement examiné des noms de famille individuels, mais vraiment tous ceux qui existaient dans chaque génération. Il est très important de toujours considérer cela sous un angle nouveau, car il y a constamment des migrations qui peuvent assouplir et mélanger les structures sociales. Nous l'avons également observé au fil du temps. Il est intéressant de noter que nous avons constaté une certaine fluctuation de l'influence parentale au cours des 15 générations. La plupart du temps, en période de crise, de guerre, de séparation cantonale, etc., la perméabilité était plus faible, c'est-à-dire que la mobilité sociale était plus faible, puis elle augmentait à nouveau. C'est un mouvement de va-et-vient. On sait par exemple qu'après les crises et les guerres, les inégalités diminuent généralement et que les chances d'ascension sociale ont tendance à augmenter à nouveau.
Mais nous ne nous sommes pas seulement intéressés à la relation parents-enfants, nous voulions également savoir comment cela affectait les générations suivantes. Et c'est passionnant: les grands-parents expliquent encore environ la moitié de ce que les parents expliquent, ils n'ont donc plus qu'un effet réduit de moitié.
L'effet des arrière-grands-parents n'est déjà plus statistiquement vérifiable. Nous avons trouvé cela impressionnant, car on dit communément: «La première génération crée la fortune, la deuxième peut encore la gérer, mais à la troisième, la situation devient critique et la quatrième n'est plus aussi couronnée de succès.»
Nous appelons cela «l'effet Buddenbrock» de Thomas Mann. Cela signifie que l'influence familiale s'éteint en l'espace de quatre générations. Cela montre une fois de plus à quel point la société suisse est perméable. C'est un beau signe qui montre que tout ne dépend pas seulement du nom de famille, mais qu'il faut aussi se démener soi-même pour réussir.
C'est très important si l'on veut une société équitable. Avez-vous une hypothèse pour expliquer pourquoi cela s'arrête après la troisième génération? Est-ce parce que les membres de la famille ne font plus vraiment d'efforts, ou qu'en pensez-vous?
Oui, c'est difficile à dire. Nous examinons toutes les données. Il est très difficile de distinguer des destins individuels. Ce que l'on constate toutefois, c'est que les grands-parents, par exemple, peuvent encore avoir un contact direct avec la jeune génération. On sait aussi que certaines aptitudes peuvent sauter une génération et réapparaître dans la suivante. Pour certaines caractéristiques, il est logique qu'il existe encore un certain lien avec les générations précédentes. Mais comme la plupart des gens n'ont probablement pas connu leur arrière-grand-père personnellement, cet effet est peu probable.
Cela signifie qu'il ne suffit pas de venir d'une famille aisée.
Oui, du moins pas à long terme. On pourrait donc dire que cela aide de venir d'une famille aisée ou d'une famille cultivée, mais l'effet n'est pas durable. Trois, peut-être deux générations au maximum, mais pas plus.
Exactement, et c'est pourquoi il est important de combiner cela avec la compréhension de la situation actuelle. Les économistes diraient aussi: «À long terme, nous serons tous morts» – en quoi cela m'intéresse-t-il si mon arrière-grand-père n'a plus d'influence sur moi? Je veux avoir des possibilités d'ascension sociale intactes aujourd'hui.
C'est pourquoi nous avons examiné dans quelle mesure le milieu familial explique le revenu. Et il est remarquable que ce ne soit que 15 pour cent. Ainsi, même au sein de ces deux générations, ces possibilités d'ascension sociale existent en Suisse.
Si nous examinons maintenant la répartition actuelle des richesses en Suisse, dans quelle mesure sont-elles réparties de manière égale ou inégale?
Il est bien sûr difficile de comparer directement les revenus et la fortune. Le pour cent le plus riche détient 40 pour cent de la fortune totale, sans compter les actifs des caisses de pension.
Cependant, nous ne pouvons pas comparer directement ces chiffres, car le revenu est une valeur fluctuante qui est générée chaque année. En revanche, la fortune est cumulée et constitue une valeur fixe.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pour cent le plus riche détient environ 40 pour cent de la fortune totale. Cependant, si l'on tient compte des caisses de pension – il n'existe ici que des estimations –, on arrive à environ 30 pour cent pour le pour cent le plus riche. C'est nettement moins que 40 pour cent. Il s'agit là d'une particularité de la Suisse: pour de nombreux Suisses, l'avoir de la caisse de pension constitue la plus grande partie de leur fortune.
Il est intéressant de noter que les inégalités de revenus sont restées très stables au cours des 100 dernières années. Les inégalités de fortune ont toutefois augmenté. Dans les années 2000, nous avons constaté une légère hausse.
Comment cela est-il possible alors que les revenus et la fortune sont liés?
Nos recherches montrent que la fortune est une grandeur très complexe. Les héritages jouent certes un rôle, mais ils n'expliquent pas l'augmentation des inégalités.
L'afflux de fortunes provenant de l'étranger – c'est-à-dire les personnes riches qui s'installent dans le pays et augmentent ainsi les inégalités de fortune?
Oui, exactement. Lorsque l'attractivité d'un site augmente, nous avons plus de fortune. Cela conduit à son tour à une augmentation de la richesse et donc à une plus grande inégalité de richesse. Cela explique environ un sixième de cette évolution.
Un autre élément important est l'évolution des marchés boursiers. C'est la grande différence que nous avons constatée. Elle ne réside pas dans les revenus du capital tels que les dividendes – cela se refléterait sinon dans l'inégalité des revenus – mais dans l'évolution de la valeur comptable.
En période de taux d'intérêt bas et de politique monétaire expansionniste, les gains comptables ont augmenté. Une grande partie de ces gains se retrouve donc sur le marché des capitaux. C'est une raison importante, tout comme la hausse des prix de l'immobilier qui en a résulté. Cela signifie que la fortune et la concentration de la fortune sont beaucoup plus complexes et multidimensionnelles que la simple répartition des revenus. Pour devenir riche, il faut avoir des revenus. Mais le facteur décisif, c'est-à-dire la question de savoir s'il faut investir dans des actions ou dans l'immobilier, est déterminant.
Cela nous amène au sujet suivant: la prévoyance vieillesse. Comme je l'ai dit, si l'on ajoute les actifs des caisses de pension, les inégalités de fortune sont nettement moins importantes. Cela signifie que, compte tenu de l'évolution du marché des capitaux, il est extrêmement précieux que nous disposions en Suisse d'un deuxième pilier solide dans le domaine de la prévoyance vieillesse. Cela permet aux classes sociales défavorisées de participer à l'évolution du marché des capitaux.
Peut-on donner une estimation approximative de la taille du deuxième pilier, par exemple du capital qu'il contient, ou encore de son rapport avec la performance économique?
Oui, c'est très impressionnant: nous avons 152 pour cent de notre performance économique sous forme de capital de caisses de pension. Nous faisons partie des élèves modèles, mais nous ne sommes pas en tête. Les Danois, par exemple, ont 192 pour cent de leur rendement économique dans le capital des caisses de pension. Si l'on regarde les pays voisins, ce chiffre est de 11 pour cent en France et de 7 pour cent en Allemagne. C'est vraiment presque rien. C'est la grande différence que nous avons avec notre deuxième pilier solide.
La question de la consommation par rapport à l'investissement s'applique au niveau individuel, mais aussi au niveau d'un pays entier, ou d'une économie nationale.
Exactement, c'est très important. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect est l'élargissement de la fortune. En d'autres termes, différents groupes de revenus peuvent également constituer un patrimoine. Nous constatons qu'il est important d'investir pour se constituer un patrimoine. Exactement, et c'est ce que nous avons avec le deuxième pilier. Il y a en quelque sorte trois contributeurs: premièrement, les assurés eux-mêmes, c'est-à-dire les salariés, deuxièmement, les employeurs et troisièmement, le marché des capitaux, qui intervient en tant que troisième contributeur avec l'effet des intérêts composés lorsque les cotisations sont investies pendant des années. Nous en revenons à la culture financière. L'effet est important à long terme.
Les milieux de gauche ont, comme on le sait, une préférence pour le système de répartition, tel que nous l'avons avec l'AVS, où rien n'est épargné. L'argent des actifs est directement versé aux retraités. Contrairement au système des caisses de pension, dans lequel le capital est investi. Quelle serait la conséquence d'un système de répartition pur?
Je pense que d'un point de vue économique global, il faut dire que la prévoyance vieillesse doit de toute façon toujours être financée par le processus économique en cours. Les fonds doivent bien provenir de quelque part. C'est pourquoi le financement ne joue pas un rôle si important, mais il joue un rôle très important en matière de répartition, comme vous l'avez mentionné. Si l'on considère un système de répartition pur, par exemple notre AVS actuelle, nous avons bien sûr des effets de répartition très différents. En effet, nous avons un système unique en Suisse avec des cotisations AVS non plafonnées. Nous payons des cotisations AVS sur l'ensemble du salaire, mais le montant maximal versé est d'environ 2'500 francs par mois.
Ainsi, ceux qui gagnent bien leur vie subventionnent l'AVS.
Exactement, il paie une sorte d'impôt sur la partie qui n'est plus prise en compte pour la constitution de sa rente. Cela signifie que nous avons beaucoup plus de redistribution dans le premier pilier. C'est important, car c'est aussi l'idée du premier pilier: garantir le minimum vital. Cette redistribution est nécessaire ici. L'idée est justement que même les personnes qui n'ont pas eu de revenu professionnel, par exemple, bénéficient tout de même d'une certaine sécurité.
Mais si l'on examine le deuxième pilier, on constate que chacun épargne pour soi-même et participe au marché des capitaux. Si l'on élargissait le premier pilier, nous aurions de nombreux problèmes. Premièrement, nous n'aurions plus le même potentiel d'investissement, car celui-ci serait simplement transféré de la génération active à la génération des retraités.
Cela signifie que l'ensemble des rendements du marché des capitaux ne pourrait plus être exploité, car l'épargne ne s'étendrait plus sur tout le cycle de vie. C'est un point important. Deuxièmement, nous avons également le changement démographique.
Il y a de plus en plus de personnes âgées. Aujourd'hui, le rapport est d'environ un pour trois. Cela signifie qu'un retraité est financé par trois jeunes. Nous prévoyons un rapport d'un pour deux d'ici 2050. C'est un autre aspect pour lequel il est bien sûr plus simple d'organiser le système par capitalisation, afin que chacun puisse épargner pour soi-même et utiliser le marché des capitaux comme troisième contributeur.
La redistribution que vous avez mentionnée, qui est intégrée dans l'AVS par le plafonnement des montants versés, est en fait une redistribution des revenus et non des fortunes, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai, et ce que j'ai mentionné précède même toute redistribution. Nous avons examiné l'effet de redistribution fiscale, qui réduit encore davantage les inégalités. Si l'on ajoute l'AVS à cela, on constate même une réduction supplémentaire des inégalités, car les cotisations AVS sont en quelque sorte un impôt pour les revenus élevés.
Les compétences financières et économiques peuvent-elles contribuer à réduire les inégalités économiques?
Il existe en effet des études qui montrent le lien entre les inégalités et la culture financière. En particulier lorsque je parle de culture économique: les compétences en matière de prévoyance expliquent en effet une grande différence dans le capital vieillesse. C'est important, car il s'agit d'une compétence qu'il est préférable d'acquérir dès le début. Si on ne la possède pas, on se retrouve pour ainsi dire prisonnier d'un cheminement prédéterminé, car on passe à côté de l'effet des intérêts composés pendant des années, voire des décennies, ce qui creuse des écarts importants. Cela signifie que, pour réduire les inégalités de revenus et de patrimoine, il est souhaitable que les gens aient des connaissances économiques et financières.
Avons-nous besoin d'une nouvelle matière scolaire qui favorise la compétence financière?
Je pense que si l'on regarde les emplois du temps, il ne reste pas beaucoup de place, mais il est certainement bon de l'intégrer. C'est également l'objectif des différents programmes scolaires.
Quel taux d'épargne ou d'investissement puis-je avoir? C'est ainsi que l'on initie les jeunes le plus tôt possible. L'endettement des jeunes est un sujet important. Il est donc essentiel de savoir dès le départ combien on gagne et à combien s'élèvent ses dépenses. Il faut comprendre ce que signifie acheter à crédit et se demander si le financement d'une moto ou d'une voiture est judicieux ou s'il ne vaut pas mieux attendre encore un peu. Et lorsque l'on s'offre une moto, une voiture ou de grandes vacances, on devrait peut-être aussi songer à épargner ou à investir certaines sommes. Il faut s'y mettre le plus tôt possible. Mais ce n'est pas seulement une question scolaire, c'est aussi une question privée. On fait ses premières expériences avec l'argent de poche. On se rend compte: «Ah, si je mets ça de côté, je pourrai m'acheter plus de choses.»
Madame Häner-Müller, ce fut très intéressant. Je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous, chères auditrices et chers téléspectateurs. À la prochaine fois.
A propos de l'auteur

Fondateur et CEO de True Wealth. Après avoir obtenu son diplôme de physicien à l'École polytechnique fédérale (EPFZ), Felix a d'abord passé plusieurs années dans l'industrie suisse, puis quatre ans dans une grande compagnie de réassurance, dans la gestion de portefeuille et la modélisation des risques.
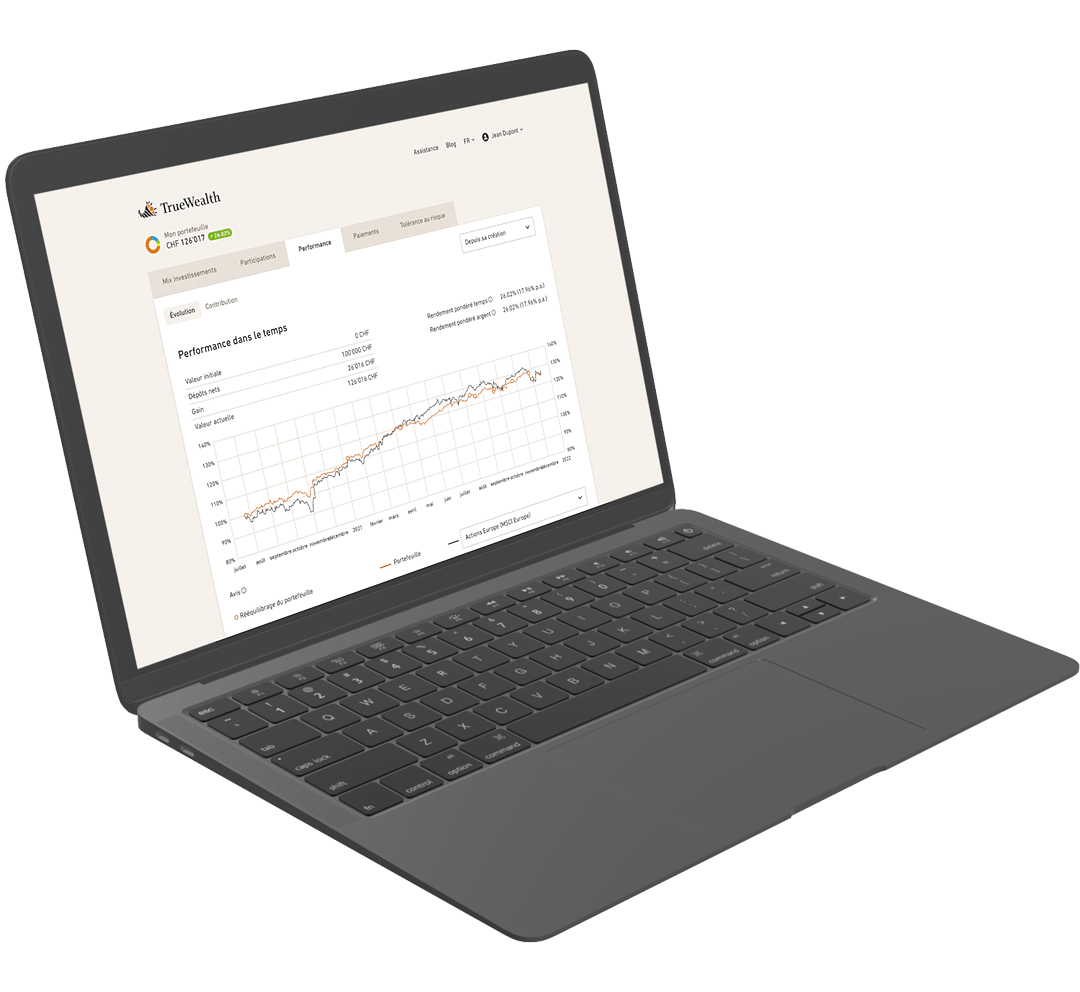
Prêt à investir?
Ouvrir un compteVous ne savez pas par où commencer? Ouvrez un compte test maintenant et convertissez-le en compte réel plus tard.
Ouvrir un compte de test